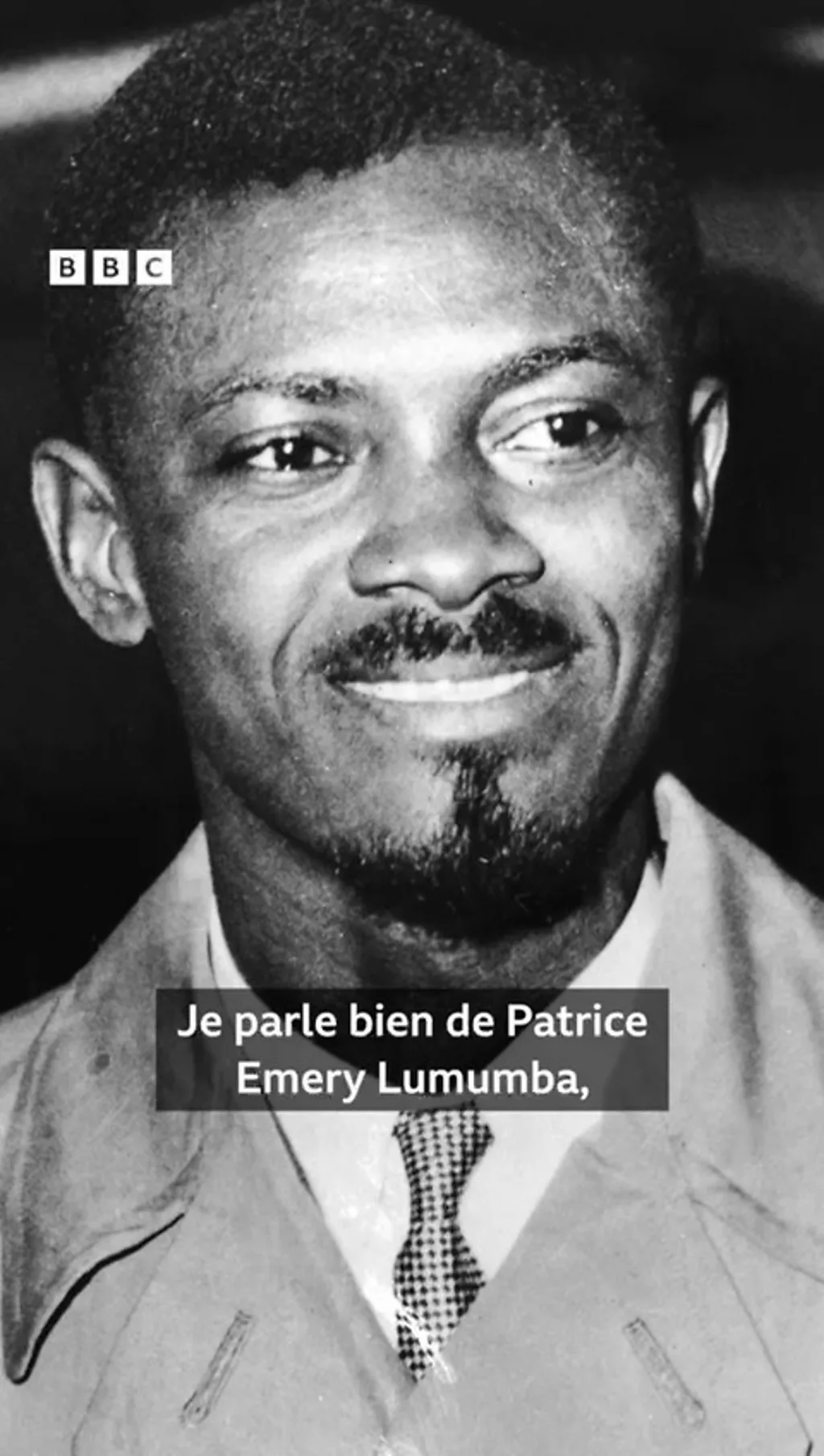Comment les réfugiés vivent leurs traumatismes et leurs souffrances à cause des conflits

Crédit photo, Innocent Buchu
- Author, Mamadou Faye avec Innocent Buchu
- Role, Journaliste digital
- Reporting from, Dakar
En RDC, plusieurs personnes sont mentalement affectées par les expériences traumatiques liées aux conflits. Des familles déplacées par la guerre de Kanyaruchinya, dans le territoire de Nyiragongo en province du Nord-Kivu, se sont réfugiées dans les écoles au nord de Goma. Elles ont fait état de leurs traumatismes à notre correspondant Innocent Buchu, depuis Goma.
Originaire de Kibumba, Noella Elisabeth a fui sa localité avec ses 5 enfants, il y a deux semaines.
Ayant grandi avec le spectre de la guerre, la jeune femme, allaitant son bébé dans une hutte de fortune faite de sacs de riz vides, est visiblement fatiguée par les nombreuses nuits blanches alimentées par des cauchemars faisant revivre les cris de détresse sous le crépitement des balles des assaillants.
"Chez nous, c’est le terrain de la guerre. On ne peut pas finir l’année sans des agitations de guerre. On ne sait pas d’où vient l'ennemi. On entend seulement des bombes, des balles, tomber brutalement. On dort à l’extérieur, à la belle étoile avec la hantise d’être kidnappés. On ne vit que souffrance sur souffrance", explique Noella Elisabeth.
Goma, terreau de peurs et de traumas
En réalité, ils ont hérité de la peur qu’avaient bien connu leurs parents à leur époque.
"Depuis ma naissance, ma mère me raconte des histoires sur la guerre. Aujourd’hui, nous vivons l'expérience par nous-mêmes. Nous ne pouvons rien changer sans Dieu", dit-elle.
"Ces conflits me font souffrir et me font rater le goût de vivre sur terre. Quand je fuis avec ce bébé si petit, quand je fuis avec mes 5 enfants sans savoir où je vais, c'est très dur. Et je n’ai aucun proche pour m’aider. Tout le monde souffre. Les déplacements à tout moment nous font vraiment souffrir", poursuit la jeune femme.
Cette quête perpétuelle de sécurité n'est pas sans conséquence. La faim, les maux de tête, l'insomnie sont les pris à payer.
"Nous avons des maux de tête régulièrement, les gens souffrent et meurent d'hypertension artérielle, mais aussi des accidents pendant la fuite. Nous souffrons vraiment", indique Noella Elizabeth.
"Quand tu te retrouves brusquement attaqué par l’ennemi, la tension monte. Beaucoup sont morts d'arrêt cardiaque et enterrés pour ça", révèle-t-elle.
Affamés face à un lendemain incertain

Crédit photo, Innocent Buchu
Des informations vérifiées à portée de main
Cliquez ici et abonnez-vous !
Fin de Promotion WhatsApp
Elisha Biyabo Sadiki, âgé de 22 ans, a lui aussi trouvé refuge avec ses quatre enfants dans le camp au nord de Goma.
"J’ai quatre enfants. Tu sais on se marie très tôt au village. J’ai fui ici avec mes 4 enfants. On est là dans la souffrance", dit-il.
"Depuis ma naissance, on ne parle que de la guerre. Mais celle-ci nous dépasse. On vit ici sans nourriture. Tout est cher. Alors on souffre seulement", affirme-t-il.
"Pour dormir, c’est sans matelas. La pluie s’abat sur nous et plusieurs d’entre nous n’ont pas de bâches, et utilisent les moustiquaires comme abris. C’est la souffrance", dit-il.
"Quand tu dors ici sous la pluie et que tu as fui sans tes parents, tu es seul avec les enfants sans souliers, sans rien, alors la tête pense à tout ça et ta mémoire est troublée", indique Elisha Biyabo Sadiki.
"Tout cela peut détruire la tête parce que là où nous sommes, nous n’avons aucune idée du jour où nous pourrons rentrer dans nos villages. Les soldats rappellent toujours à ceux qui veulent rentrer chez eux qu’il y a encore la guerre. Alors la tête est troublée parce qu’on réfléchit trop sur la famille parfois séparée. J’imagine ceux qui se retrouvent ici seuls", indique le jeune père.
Troubles mentaux, insomnie et faim

Crédit photo, Innocent Buchu
Le révérend pasteur Byamungu Wakabi Xavier est lui âgé de 62 ans. Marié et père de sept enfants, il vit depuis quatre mois et demi dans le camp de réfugiés.
Originaire de Rugari, dans le territoire de Rutshuru, il a fui la guerre pour se réfugier dans le site de Kanyaruchinya où il souffre avec sa famille de faim.
"Nous sommes en train de souffrir de faim ici. Nous vivons vraiment une souffrance que nous n’avons jamais vu depuis la naissance", dit-il.
"Ces conflits détruisent ma vie parce que presque chaque année je suis obligé de fuir. Nous perdons des biens de valeurs. Nos enfants meurent, nos mamans mortes, les hommes meurent. Tout ce que nous avons est pillé chaque jour. Et voilà nous sommes traumatisés. Si tu fais un check des têtes de toutes ces personnes ici, ils sont tous comme des sorciers", raconte-t-il.
Pesant 85 kg jadis, il a perdu une quinzaine de kilos à cause du traumatisme et du stress lié à la précarité de tous les jours.
"Quand je fuyais je pesais 85 kg, aujourd’hui j'en pèse 70 parce que je mange mal et je dors dans de mauvaises conditions. Je ne sais pas quoi faire. C’est pourquoi parfois je dors même sans prier à cause des réflexions."
"A vrai dire, plusieurs personnes ici sont atteintes de troubles mentaux à cause des détonations des bombes, des balles, du manque de sommeil, de la faim, etc. La souffrance de tout genre fait que les gens ont l’air d’être fous", explique le pasteur.
"On nous raconte aujourd’hui que plusieurs personnes qui n’avaient pas fui le M23 sont mortes. A Rugari, on nous parle de 27 morts qui sont laissés en plein air, qui sont devenus des nourritures pour les chiens et les corbeaux", révèle-t-il.
Le traumatisme des enfants

Crédit photo, Innocent Buchu
L'école Primaire Mboga située à Kanyaruchinya fait partie des établissements qui abritent les réfugiés.
Plusieurs familles de déplacés, des hommes, des femmes, des vieux et des enfants vivent dans les salles des classes.
Seules quelques familles, certainement les premières venues, ont eu la chance de trouver de la place. Devant l’école, plusieurs autres familles vivent dans des abris construits à base de sacs et de bâches. D’autres ont installé leur tente au bord de la route, dans des conditions très précaires.
Dans ce camp de réfugiés, comme partout ailleurs, ce sont généralement les enfants qui souffrent le plus de traumatismes. Ils ne peuvent pas comprendre ce qui leur arrive, la raison pour laquelle ils ont perdu tous les privilèges et le confort de la vie en famille, en temps de paix.
Ils posent alors beaucoup de questions dont les parents ne trouvent pas les réponses à leur niveau. Ce qui accentue leur traumatisme et leur souffrance.
"Les enfants étaient habitués à bien manger, à bien se vêtir, à aller à l’école, ils prenaient la bouillie, ils mangeaient à leur goût, mais aujourd’hui nous n’avons rien à leur donner et ils n’étudient pas. C’est pourquoi ils sont traumatisés, ils ont perdu la tête", renseigne le pasteur Byamungu Wakabi Xavier.
Pour Noella Elizabeth, sa vie et celle de ses enfants se sont transformées en un véritable cauchemar.
"La situation n’est pas bonne. Les enfants me prennent par le pagne, ils pleurent et me disent qu’ils ont faim. Et je me demande quoi faire. Je leur dis seulement de persévérer", raconte Noella, les larmes aux yeux.
"Ici, certains reçoivent de l’aide d'autres non. Moi je n’ai rien reçu jusque-là. S’il faut dormir, on dort. Si le voisin a quelque chose à donner aux enfants, il leur donne et ils se calment. Nous souffrons beaucoup", dit-elle.
"Ils me posent des questions sur le manger, et par rapport à la pluie qui s’abat sur eux. Ils demandent où nous sommes et pourquoi nous restons sous la pluie. Quand j’entends leurs questions, mes larmes coulent et ils pleurent aussi avec moi. Mais rien à faire, nous laissons tout à Dieu", explique Noella Elizabeth.
Pour sa part, Elisha Biyabo Sadiki est lui aussi pressé de questions par ses enfants traumatisés.
"Ils me demandent quand est ce qu’on rentrera chez nous, quand est-ce que la guerre prendra fin ? Et je réponds que je ne sais pas parce que je ne suis pas Dieu. Nous mettons Dieu devant, qu’il nous aide. Et que nos autorités aussi nous aident pour qu’on regagne nos villages", dit Elisha.
Le psychologue explique le vécu des déplacés
Pour comprendre cette situation traumatique que vivent les déplacés internes en RDC ou partout ailleurs sur le continent africain, nous avons fait appel à un spécialiste, un psychologue qui a une expérience de plus d'une dizaine d'années dans la prise en charge psychologique des réfugiés victimes des conflits en Afrique.
Dans cet entretien que nous avons avec Dr Romuald Stone Mbangmou*, l'expert camerounais nous explique cet univers particulier où la souffrance est le quotidien des femmes et des hommes, jeunes ou vieux, et des enfants qui sont arrachés par la violence à leur environnement naturel.

Crédit photo, DR ROMUALD STONE MBANGMOU
Dr Mbangmou, quelle est votre expérience de la vie traumatique des réfugiés en Afrique ?
L’expérience que nous avons des réfugiés déplacés en Afrique porte particulièrement sur des personnes venant de la Centrafrique, du Tchad, du Nigéria et du Niger ; particulièrement de ces quatre pays avec une prédominance des Centrafricains bien sûr où nous notons régulièrement les problèmes de type relationnel au premier plan parce que des gens sont séparés de leurs familles, des gens ont perdu leur emploi, d’autres ont dû arrêter leur parcours académique ou bien changer même de filière. Et tout cela perturbe leur vie relationnelle, que ça soit familiale ou sentimentale parce que d’aucuns ont abandonné leur copain, leur copine, leur fiancée, leur femme et leurs enfants pour leur sécurité.
Après les problèmes relationnels, nous avons les problèmes psychosomatiques. On voit par exemple de jeunes femmes qui arrivent avec des perturbations de leurs cycles menstruels et qui cherchent à comprendre ce qui leur arrive parce qu’elles n’ont jamais eu cela depuis leur enfance. Elles se retrouvent alors à faire des examens médicaux et parfois ça penche même vers ce qu’on appelle l’hypochondrie parce que souvent, malgré les résultats des examens qui montrent qu’il n’y a pas un problème de santé avéré, certaines n’arrivent pas à accepter qu’il n’y a pas un problème réel.
Et après les troubles psychosomatiques, parmi lesquels on peut aussi citer les céphalées de tension, les problèmes gastriques, nous avons dans la troisième catégorie, les troubles anxieux qui sont les plus présents ou bien je dirais les plus diversifiés. Parmi ces troubles anxieux, on a l’état de seuil traumatique qu’on retrouve chez ceux qui ont été victimes de violences aigues, d’abus sexuels, de tortures et consorts. Donc on retrouve cet état de seuil traumatique chez beaucoup de réfugiés qui viennent d’arriver.
On voit l’état de stress aigu. On voit aussi chez ces gens des phobies spécifiques. Il y en a qui ont la phobie de voir des hommes en tenue. On a eu plusieurs cas où il y a eu des phobies des armes blanches. Il y en a une qui dit, ‘bon je n’arrive pas à faire la cuisine’. Si on lui demande la raison, elle dit : ‘je ne veux pas voir de couteau, je ne veux pas voir tout ce qui est tranchant. J’ai peur de me faire du mal avec.’ Et dans son histoire, on voit qu’elle a beaucoup de cicatrices sur le corps. Elle a été torturée, violée et violentée pendant plusieurs jours en République Centrafricaine par des rebelles, selon ses dires.
Donc cette expérience portant sur ces gens est une expérience suffisamment fournie parce que nous sommes sur le terrain depuis 11 ans aujourd’hui et nous avons reçu beaucoup de déplacés ici à Yaoundé, au Cameroun.
Qu'est-ce qui traumatise réellement ces populations qui ont pourtant eu la chance d'être secourues ?
Oui, elles ont eu la chance d’être secourues, mais sauf qu’avant d’être secourues il y a des choses qui se sont passées. Et quand bien même elles ont été secourues, il y a une vie qu’on laisse derrière qui est l’un des premiers facteurs.
Se séparer de son environnement de naissance, se séparer de son environnement habituel, de son environnement de confort pour aller refaire une vie dans un autre territoire, ce n’est pas quelque chose d’aisée. L’être humain vit de sentiments, d’attachements. On dit que nous sommes des êtres sociaux.
Donc, quand on a déjà réussi à se socialiser dans un espace et que demain on nous fait partir de là, souvent même avec notre volonté, même quand c’est ce qu’on souhaite, ça pose problème.
Et on voit ça régulièrement avec les Africains qui réussissent à avoir un visa pour aller en Europe, en Occident. Vous voyez généralement dans les aéroports que ce sont des pleurs. Celui qui part est en train de pleurer, ceux qui l’accompagnent sont fiers parce que leur frère, leur enfant, leur époux est en train d’aller au paradis entre guillemets.
Mais ils sont en train de pleurer parce que la séparation avec ses proches, la séparation avec son environnement, la séparation avec son histoire, rien que ça peut expliquer pourquoi il y a du traumatisme.
Or, avant ça, il y a la situation traumatogène ou traumatique que ces gens ont vécu. Donc, le fait de les avoir secourus n’empêche pas forcément que le traumatisme ne s’installe. Non pas du tout. Ce n’est qu’une prise en charge ici corrélée avec la capacité du sujet à faire face, à résister à des situations, à se reconstruire psychologiquement. Ce ne sont que ces éléments qui permettent ici de surmonter le traumatisme.
Quels sont les exemples qui vous ont le plus marqué en tant que psychologue clinicien ?
Comme exemples, on peut citer quelques cas comme celui de Mlle Anna qui est une Centrafricaine qui a quitté la Centrafrique. Je pense que je l'ai reçue en 2018. Elle a été victime d'abus sexuels et ses parents se sont arrangés avec l'aide d'une ONG pour qu'elle arrive à l'est du Cameroun où elle a fait quelques mois.
C'est la même ONG qui l'a fait passer à Yaoundé pour qu'elle continue ses études. Etant très brillante quand elle était en Centrafrique, ses capacités ont complètement baissé quand elle a repris le chemin de l'école ici un après. Alors qu'elle suivait les Sciences économiques, elle a préféré finalement arrêter l'école pour faire quelque chose de moins contraignante sur le plan cognitif, donc mentalement.
Son cas ne s'est pas arrêté là. Ce qu'elle a vécu a fait qu'elle a développé un traumatisme, une phobie des hommes, parce qu'elle a été abusée sexuellement plus de trois fois. Arrivée au Cameroun, elle dit qu'elle se sent plus attirée par les femmes que par les hommes. Et apparemment plus le temps passe, cela n'a fait qu'augmenter.
Pour son cas, je ne pense pas que c'est le fait de se déplasser qui ait provoqué peut-être cette déviance sexuelle mais cela y a sûrement contribué. Parce que si elle était peut-être restée en RCA, dans son pays, elle serait peut-être en train de continuer les rencontres avec son petit ami de là-bas ou bien ses camarades et consort et les choses auraient peut-être évolué dans un autre sens.
Il y a le cas de Frédéric qui est venu du Tchad du fait de Boko Haram. Je pense que nous l'avions reçu en 2016 ou 2017. Il a dû particulièrement fuir le village, aidé par une ONG installée à la limite du Cameroun et du Tchad. Selon lui, les éléments de Boko Haram l'avaient identifié comme quelqu'un qui passait des informations à l'armée.
A partir de là, ils ont eu à éliminer plusieurs membres de sa famille dont il était le seul rescapé. Quand il est arrivé à Yaoundé, il s'est mis à se culpabiliser en disant que c'est à cause de lui qu'il a perdu toute sa famille. On a vu en lui une dépression qui s'est installée et qui a suffisamment pris racine. Mais on a fait le travail comme on pouvait. C'est vrai que ce sont des trucs, même quand on se remet d'une telle dépression, rien ne prouve qu'on ne va pas ressombrer demain.
Il y a un cas qui est même encore d'actualité, que nous avions reçu depuis 2016. Là, c'est un enseignant qui est jusqu'aujourd'hui dans un hôpital de la place ici à Yaoundé. Il est venu avec sa fille qui devrait avoir dans les 8 ou 9 ans à leur arrivée à l'hôpital. La jeune fille était victime d'une explosion qui finalement avait laissé une fragmentation dans sa colonne vertébrale.
On devrait l'opérer quand elle était arrivée mais on a vu qu'elle risquait la paralysie totale. Elle est paraplégique déjà et elle est restée à l'hôpital sur la prise en charge du gouvernement. Depuis 2016, je vous dis, elle est à l'hôpital avec son papa qui a tout abandonné.
Déjà, il faut noter que dans l'explosion, son dernier petit frère et sa maman sont décédés. La fille a deux frères qui sont restés au nord. Alors la famille est séparée depuis 2016. Le père travaille déjà comme un personnel de l'hôpital. La fille est là, elle va à l'école mais elle présente régulièrement des cycles dépressifs. On peut citer des tas de cas comme ça mais ce qui est sûr, ce n'est pas quelque chose de facile.

Crédit photo, DR ROMUALD STONE MBANGMOU
Comment se manifestent généralement les comportements traumatiques ?
Les comportements traumatiques peuvent se manifester de plusieurs façons en fonction du profil de personnalité de l'individu, en fonction de son niveau de résilience, en fonction du niveau de traumatisme et de son niveau de tolérance. Et les répétitions et consort, les degrés d'exposition, font que certaines personnes développent l'état de stress aigü.
Donc, c'est directement après le traumatisme que le sujet commence à présenter des symptômes, les céphalées, les somatisations comme les variations des paramètres physiologiques, l'hypertension artérielle, la hausse de la glycémie peuvent se déclencher en très peu de temps. Cela peut se manifester là par un pic de glycémie, un pic de tension, ça peut se manifester par les pertes de connaissance, les oublis, les douleurs gastriques.
On va voir les modifications concomittentes aux émotions qui vont caractériser ce qu'on appelle l'état de stress aigü, c'est-à-dire l'état de stress qui nait directement ou seulement quelques temps après l'exposition aux traumatismes. Maintenant, après ça on a ce qu'on appelle l'état de stress post-traumatique. Là généralement, les symptômes apparaissent au moins un mois après l'exposition à l'évènement traumatogène.
Et cela se manifeste généralement avec, soit les évitements, donc le sujet commence à éviter les situations qui sont plus ou moins en rapport avec ce que la personne a vécues, soit le retournement au sens contraire. Donc le sujet essaie en ce moment de faire le contraire de ce qui s'est passé : soit l'identification à l'agresseur.
On a vu des filles, après avoir été victimes d'abus sexuels, de viols, ont préféré intégrer des gangs où elles peuvent aussi abuser d'autres personnes; ca peut être des abus sexuels ou des abus en rapport ou qui se manifestent avec les escroqueries et consorts. Donc, on a des gens qui développent des phobies de certaines situations.
On voit l'état de stress, d'anxiété généralisée, en fait les troubles anxieux chez certains patients ou certains malades. On voit aussi les troubles psychotiques qui sont généralement l'expression de troubles obsessionnels compulsifs qu'on n'a pas pris en charge ou de l'hypochondrie qu'on n'a pas pris en charge. Donc, il y a beaucoup de troubles comme ça et des symptômes qu'on peut retrouver chez ces personnes qui sont l'expression d'un traumatisme.
On a des régressions, on a des gens qui ont des troubles relationnels. Quand on a quitté son environnement de vie où on a tout abandonné pour se retrouver dans un nouvel environnement, sous contrainte bien sûr, parce que c'est ça la chose la plus importante. Le fait de quitter sous contrainte, ça met franchement le sujet à l'épreuve et généralement ce sont des épreuves négatives.
Que peut-on faire pour leur permettre de refaire leur vie normale ?
Je pense que pour minimiser les conséquences de ces déplacements, les conséquences de ces expositions aux évènements traumatiques, on devrait se référer à la hiérarchie des besoins chez l'être humain.
Je pense qu'il y a une échelle en psychologie qui permet de mieux aborder cette hiérarchisation. C'est-à-dire, commemencer par les besoins physiologiques de base et c'est déjà, je pense, ce que beaucoup d'ONG font sur le terrain.
Les besoins physiologiques de base, manger- boire - dormir. Est-ce qu'ils ont à manger, est-ce qu'ils ont à boire, est-ce qu'ils ont où dormir ? C'est déjà bien de faire ça, mais comme on le dit, ce sont les besoins physiologiques de base, il faut aller au-delà.
Il y a le besoin de sécurité. On devrait se rassurer qu'ils sont en sécurité, qu'ils se sentent en sécurité dès lors qu'ils sont secourus. Je pense que là-bas aussi il y a plus ou moins cette sécurité mais elle n'est pas suffisante parce que beaucoup ne sortent pas de ces camps parce qu'ils se disent encore qu'ils ne sont pas en sécurité en dehors du camps.
Ce n'est que dans le camp qu'on est en sécurité. Donc, il faut encore travailler sur la sécurité de ces gens. Et où on commence à avoir un peu plus de problèmes, c'est au niveau du besoin d'amour. Je pense que l'approche des ONG est généralement mécanique. On veut aider les gens, on doit les donner à manger, à boire, on doit les faire dormir quelque part, mais on prend pas trop en compte le sentiment d'appartenance.
Ici, on ne prend pas en compte le besoin d'amour et d'appartenance. Un moyen d'appartenance c'est est-ce que ces gens se sentent aimés ? Est-ce qu'ils arrivent à maintenir un lien avec leurs proches ? Il faut tenir compte de ça. Lorsqu'on a une femme de 25 ans ou 30 ans dans un camp de réfugiés, on devrait pas seulement l'aider à manger, boire et dormir.
On doit se rassurer que la communication avec les membres proches de sa famille est effectuée efficacement. On doit se rassurer qu'elle soit en contact avec les personnes qui lui sont chères dans la vie. Maintenant après, l'estime de soi parce que beaucoup de gens qui sont des réfugiés déplacés internes se retrouvent en train de mener des activités dont ils n'ont pas appris.
Ce qu'ils ont appris, ils ne l'utilisent pas généralement et vont mener des activités qu'ils ont rencontrées sur le terrain, qu'on leur demande de faire. Donc, l'idéal serait de voir comment améliorer ou bien recycler ces personnes dans leur formation d'origine, quitte à les envoyer d'un endroit à un autre pour que ces gens reviennent demain servir plus efficacement même dans ces ONG.
Je pense que les former et les faire recruter par ces organismes permettra de mieux les aider en dépensant moins, parce qu'en ce moment ils vont faire des tâches qui seront rentables, qui pourront leur permettre d'avoir un salaire et de se refaire une vie et au même moment l'ONG ne va pas sortir l'argent pour rien.
Elle doit sortir l'argent pour payer pour une tâche. Donc, je pense qu'il faut emmener ces gens à développer l'estime de soit qui leur permettra d'être plus efficace, de vivre plus aisément de manière plus efficace et plus épanouie.
*Dr Romuald Stone Mbangmou* est psychopathologue, psychothérapeute et clinicien. Enseignant à l'université de Yaoundé 1 au Cameroun, il est promoteur et psychologue consultant au Centre Médico-Psychologique Intégratif Henri Piéron de Yaoundé. Il est l'ancien chef de service de Psychologie et Psychiatrie de l'hôpital militaire de région N01 de Yaoundé.